« La ‘théorie’, ce n’est pas seulement des mots sur une page, mais c’est aussi des choses qui se font", entretien avec Nick Mirzoeff
 Nicholas Mirzoeff, photo MTL+ En déplacement à Gorée en avril dernier, le Président de la République portugaise exposait dans son discours la persistance du colonialisme dans la société portugaise. En plein débat sur la mémoire de la colonialité ainsi déclenché, nous avons interviewé Nicholas Mirzoeff, professeur du Département de Média, Culture et Communication de l’Université de New York lors de son passage à Lisbonne où il donne le séminaire Descolonizing Media, dans le cadre du Doctorat en Études Artistiques - Art et Médiation à la FCSH-UNL.
Nicholas Mirzoeff, photo MTL+ En déplacement à Gorée en avril dernier, le Président de la République portugaise exposait dans son discours la persistance du colonialisme dans la société portugaise. En plein débat sur la mémoire de la colonialité ainsi déclenché, nous avons interviewé Nicholas Mirzoeff, professeur du Département de Média, Culture et Communication de l’Université de New York lors de son passage à Lisbonne où il donne le séminaire Descolonizing Media, dans le cadre du Doctorat en Études Artistiques - Art et Médiation à la FCSH-UNL.
Nicholas Mirzoeff se définit comme un « militant visuel qui travaille à la croisée de la politique et de la culture visuelle mondiale/digitale » et de facto, il porte sa connaissance académique (et empathique) hors du milieu universitaire pour s’impliquer dans des mouvements comme Occupy Wall Street et Black Lives Matter.
Il est un des fondateurs de la Culture Visuelle, ses publications - déjà classiques – comprennent Introduction to Visual Culture (1999/2009) et The Visual Culture (1998/2012). De nombreux autres livres ont été publiés mais The Right to Look: A Counterhistory of Visuality (2011) est un tournant dans son œuvre. Dans ce livre, Mirzoeff développe une généalogie de la « visualité », ici perçue comme « pratique discursive ». À tel point que maintenant, à chaque fois que le concept est utilisé, il doit être mis entre guillemets (ou alors être défini). Après ce travail approfondi, Mirzoeff semble avoir eu un élan pour comprendre un monde en perpétuelle évolution, dans lequel l’image joue un rôle crucial; il a publié How To See The World : An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More (2015), une œuvre qui touche un public plus large, dans la meilleure tradition de John Berger.
En même temps, il a développé de nombreux autres projets dont Occupy 2012, une espèce de journal que impliquait d’écrire un post tous les jours pendant une année sur Occupy Wall Street movement et After Occupy: What We Learned, un projet d’écriture ouverte sur les leçons du mouvement (2014). Le dernier a conduit à son plus récent livre, The Appearance of Black Lives Matter, une généalogie de « visual commons », qui part de la lecture faite par Judith Butler de « l’espace d’apparition » de Hannah Arendt et qui vient tout juste d’être édité comme e-book gratuit.
De facto, ces projets récents constituent un pas de plus dans l’effort de Mirzoeff pour ouvrir la théorie et décoloniser la connaissance - un thème qui est à l’ordre du jour mais pour lequel peu de gens savent comment faire ou se risquent à le mettre en pratique. Mirzoeff est en train d’atteindre cet objectif non seulement à travers différents canaux de publications et son militantisme mais aussi par les « humanités numériques», comme c’est le cas de son récent projet How to See Palestine: An ABC of Occupation. De Katrina à Black Lives Matter en passant par Occupy, de la Palestine à Standing Rock en passant par les Maoris, Nicholas Mirzoeff avance en tissant. Il a tissé un champ avec une chaîne et une trame de concepts, de méthodologies et de « tactiques » fondamentaux, nous enseignant comment et où regarder. Par-dessus tout cependant, il en est venu à tisser une voie à double sens entre le milieu académique et le peuple.
Les pensées, les provocations et les dérives récentes de Nick Mirzoeff peuvent être retrouvées sur son blog The Situation.
Nick est un des fondateurs de la Culture Visuelle, à défaut d’avoir une formation d’historien et d’historien de l’art. Dans son travail, vous portez ce capital fondateur tout comme les dimensions politiques et éthiques des Études Culturelles. Ainsi, dans votre cas, les accusations de « antihistoricisme » initialement faites par le « Visual Culture Questionnaire » de la revue October (1996), qui persistent d’une certaine façon encore aujourd’hui à propos de ce domaine, tombent à l’eau. De même, elles s’écroulent puisque nous n’en sommes pas à parler d’une discipline - ce ne fut jamais une telle ambition, ni même au moment de la fondation de la Culture Visuelle il y a 20 ans - mais plus d’une praxis. Nick définit la Culture Visuelle comme « une tactique pour étudier les fonctions d’un monde que l’on aborde par le biais de l’image de toute sorte et des visualisations et non au travers de textes et de mots ». On peut visualiser exactement quelle tactique, ou auparavant quelles tactiques elles sont - terme qui semble impliquer un positionnement politique? En quoi diffèrent ces tactiques des méthodes utilisées par les disciplines académiques qui traitent du visuel tout autant que l’histoire de l’art ou l’anthropologie ? Y a-t-il un certain aspect pour lequel un certain degré d’antihistoricisme peut être positif ?
Dans les années 70, Stuart Hall a commencé un projet d’étude sur la culture populaire au Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham. Il a montré clairement que l’objectif stratégique n’était pas la compréhension de la culture en tant que telle mais la possibilité de transformation sociale qui pouvait résulter de l’utilisation des Études Culturelles comme tactique. De la même façon, Hall a défendu la thèse selon laquelle la théorie est toujours un détournement du cheminement vers un autre lieu ou une autre chose. Comme quelqu’un qui grandit politiquement et intellectuellement avec ce projet, voilà ce que j’avais en tête quand j’ai déclaré que la culture visuelle est une « tactique ».
Dans le milieu disciplinaire, des méthodes sont choisies comme moyen de production de l’information sur des objets spécifiques. Mais le travail qui m’intéresse implique un positionnement contre cette disciplinarité et de facto, aspire à la renverser. Lorsque le questionnaire de October est sorti, il y a de nombreuses années, c’était surtout la pratique disciplinaire de l’histoire de l’art moderne qui était concernée par ses auteurs. Sa cible était essentiellement le programme de la culture visuelle de l’université de Rochester, sous l’égide de l’historien de l’art Douglas Crimp qui s’était isolé du groupe.
Aujourd’hui, j’ encadrerait les choses d’une façon un peu différente. Il est évident que la culture actuelle a une contrainte considérable pour la visualisation. Seuls les utilisateurs de Snapchat gèrent 2,5 millions de snaps par jour. Environ 1,2 milliard de photographies sont développées chaque année. Ces nombres modifient le projet d’une « histoire des images » en tant que telle en quelque chose de très différent. L’analyse de big data peut décomposer les nombres, comme c’est le cas pour l’analyse des selfies par la localisation, le genre et autres indicateurs, développée sur selfiecity.net. C’est donc la « culture visuelle » de notre époque : une circulation capitalisée par des séries d’information traduite en format « visuel » sur les écrans de nos appareils, qui permet et élargit la circulation des marchandises de toutes sortes. De plus, cela prolonge la marchandisation de la perception même comme un bien monnayable. L’Américaine Mary Meeker, investisseuse en capital risque, dit pour cela « Tout est visuel, à tout heure » [All visual, all the time]. Le CISCO Networks prévoit que plus de 80 % des réseaux sociaux seront basés sur la vidéo dès 2021. Ce que ces capitalistes proposent de faire est de raccourcir la distance entre le monde numérique et le mode matériel – pour eux, cela équivaut à vendre des choses, que ce soit des biens ou des services. Et ils deviennent à chaque fois meilleurs dans ce domaine et cela très rapidement.
Pour cela, mon objectif n’est pas tant de viser une cartographie complète de ces matériels capitalisés/visualisés mais de les utiliser avant – tout comme moyens pour cartographier le changement, puis pour produire la transformation sociale. J’appelle ça le militantisme visuel qui cherche à s’impliquer avec la culture visuelle existante. Un exemple plus clair peut-être de ce que je veux exprimer ici serait le mouvement Black Lives Matter. La photographie et la vidéo vernaculaires ont montré clairement qu’il existe dans les phrases agressives du Movement for Black Lives, « une guerre contre les personnes noires ». Mais ces images ont été aussi un catalyseur pour le changement. Tout d’abord, les mouvements associés au Black Lives Matter (qui est un réseau décentré de sections autonomes) ont cherché à obtenir la condamnation des policiers qui utilisent ces matériels comme preuve. Comme il est évident qu’aucune preuve visuelle ne servirait pour mobiliser le ministère public et la justice, l’objectif est devenu systémique. L’intention de défier le racisme systémique et l’incarcération en masse a tant d’objectifs tactiques à court terme, souvent réalisables dans un cadre juridique et des règlements en vigueur, quant à la transformation systémique, un exemple en est la nécessité d’offrir des indemnisations.
Entrer dans l’espace public pour défier la suprématie blanche est déjà faire un pas « hors de l’histoire », comme l’a fait remarquer Benjamin. Car l’histoire a été une suite de défaites des opprimés et des damnés de la terre. C’est tactiquement important de la mettre de côté au moment de l’action. Non pas pour oublier l’inégalité systémique mais pour rendre l’action possible. Le poids de l’histoire telle qu’elle nous est enseignée est qu’« ils » gagnent toujours. La chance de l’histoire, telle que nous pouvons occasionnellement la vivre, est l’opportunité lumineuse de trouver une façon de vivre.
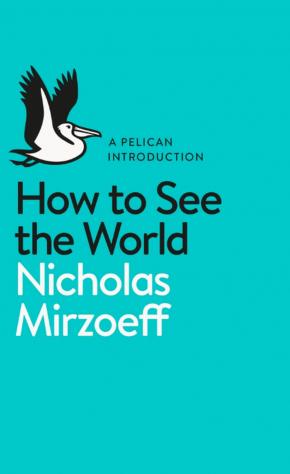 'Entrer dans l’espace public pour défier la suprématie blanche est déjà faire un pas 'hors de l’histoire', comme l’a fait remarquer Benjamin (…). Le poids de l’histoire telle qu’elle nous est enseignée est qu’ils' gagnent toujours. La chance de l’histoire, telle que nous pouvons occasionnellement la vivre, est l’opportunité lumineuse de trouver une façon de vivre'. Au Portugal, le domaine de la Culture Visuelle est dans une phase embryonnaire, étant donné qu’une partie de son jargon et de sa transdisciplinarité a été appropriée à d’autres domaines ou adoptée, à l’université, sous l’égide du nom Études Artistiques. Ainsi dit, les dimensions politiques et éthiques de la Culture Visuelle sont dans de nombreux cas, mises de côté. Dans le travail de Nick, ce positionnement politique et éthique est crucial et vous avez pris position par la diversification des canaux de production scientifique (ce que McKenzie Wark a appelé low theory), de la publication sur des plateformes en accès libre, de la participation à la Free University de New York et à l’Anti-University de Londres, et de son engagement dans des mouvements sociaux. De cette façon, Nick a contribué activement au débat passionné autour de la décolonisation de la connaissance, récemment renforcé par les évènements entraînés par les étudiants de la School of Oriental Studies de Londres et par le mouvement The Rhodes Must Fall en Afrique du Sud. À ce sujet, il a aussi souligné que la culture visuelle « n’est pas une discipline académique; [mais] vous espérez aller au-delà des frontières traditionnelles de l’université pour interagir avec les vies quotidiennes des individus ». À la FCSH-UNL, vous êtes venu donner le séminaire Descolonizing Media – Change your Worldview qui a une component très participative, en s’engageant à travers différentes lectures qui apportent un cadre conceptuel pour ces débats. Sur le blog du programme, à l’onglet « Comment nous travaillons », Nick souligne que « participer est un acte de solidarité. Ceci n’est pas un espace disciplinaire mais un espace de compromis ».
'Entrer dans l’espace public pour défier la suprématie blanche est déjà faire un pas 'hors de l’histoire', comme l’a fait remarquer Benjamin (…). Le poids de l’histoire telle qu’elle nous est enseignée est qu’ils' gagnent toujours. La chance de l’histoire, telle que nous pouvons occasionnellement la vivre, est l’opportunité lumineuse de trouver une façon de vivre'. Au Portugal, le domaine de la Culture Visuelle est dans une phase embryonnaire, étant donné qu’une partie de son jargon et de sa transdisciplinarité a été appropriée à d’autres domaines ou adoptée, à l’université, sous l’égide du nom Études Artistiques. Ainsi dit, les dimensions politiques et éthiques de la Culture Visuelle sont dans de nombreux cas, mises de côté. Dans le travail de Nick, ce positionnement politique et éthique est crucial et vous avez pris position par la diversification des canaux de production scientifique (ce que McKenzie Wark a appelé low theory), de la publication sur des plateformes en accès libre, de la participation à la Free University de New York et à l’Anti-University de Londres, et de son engagement dans des mouvements sociaux. De cette façon, Nick a contribué activement au débat passionné autour de la décolonisation de la connaissance, récemment renforcé par les évènements entraînés par les étudiants de la School of Oriental Studies de Londres et par le mouvement The Rhodes Must Fall en Afrique du Sud. À ce sujet, il a aussi souligné que la culture visuelle « n’est pas une discipline académique; [mais] vous espérez aller au-delà des frontières traditionnelles de l’université pour interagir avec les vies quotidiennes des individus ». À la FCSH-UNL, vous êtes venu donner le séminaire Descolonizing Media – Change your Worldview qui a une component très participative, en s’engageant à travers différentes lectures qui apportent un cadre conceptuel pour ces débats. Sur le blog du programme, à l’onglet « Comment nous travaillons », Nick souligne que « participer est un acte de solidarité. Ceci n’est pas un espace disciplinaire mais un espace de compromis ».
Il est évident que la Culture Visuelle n’est pas possible sans une dimension politique et éthique. Comment avez-vous imaginé le rôle actuel de ce domaine dans le mouvement de décolonisation de la connaissance et de l’imagination ou, comme vous avez dit dans un récent article publié dans The Nordic Journal of Aesthetics, que faire pour effectivement « vider le musée, décoloniser le curriculum et ouvrir la théorie » ?
Comme je l’ai dit, la question est de savoir comment développer un militantisme visuel dans la culture visuelle actuelle, capitaliste et mondiale. Cette question établit un lien entre le travail critique et le militantisme, au sein et hors du champ de l’éducation et de la production du savoir. Pour moi, l’existence d’un « domaine » de culture visuelle au sein de l’université n’est pas évidente. Quand le secteur des études cinématographiques [cinema studies] s’est mis en place dans les années 70, il a aussi eu du mal à trouver sa place. Pourtant, le cinéma a été plus largement reconnu comme un medium avec un mérite artistique – grâce aux grands films des années 70 – et la théorie du cinéma a gagné un domaine d’influence beaucoup plus grand. En résumé, les études de cinéma avaient un « sujet » reconnu et un dispositif théorique pour les soutenir.
À utiliser l’expression « culture visuelle », pratique qui remonte aux années 60, notre domaine d’investigation a été entravé par un effort inéluctable pour expliquer la culture comme un tout en termes de matériels visuels. Maintenant, on envisage une seconde opportunité pour ce domaine. Avec l’avènement des images numériques vernaculaires, des selfies aux vidéos sur YouTube et particulièrement, la documentation sur la résistance politique, il y a un « sujet » précis qui n’est pas l’histoire de l’art, le cinéma ou la télévision mais qui a une importance palpable. Si ces images arrivent à trouver des théoriciens importants – s’ils ne se résumaient pas juste à un « bip » dans l’histoire des media numériques - elles peuvent être la base d’un domaine, celui que j’appelle « pratique de culture visuelle ». Parce qu’il est possible de faire ce travail tout autant que de le commenter et utiliser ces formes pour les commenter et les critiquer.
Mais les universités sont en train de se transformer, et en général pour le pire. Les étudiants sont considérés comme des consommateurs qui par conséquent contractent d’énormes dettes. N’importe quel domaine considéré comme « interdisciplinaire » n’est pas à la mode et n’a aucun moyen financier. Donc, comme le disait Fred Moten et Stephano Harney dans The Undercommons, je vois de plus en plus l’université comme un sanctuaire potentiel local et comme une institution où « voler ». Avec cette dernière affirmation, Moten et Harney ont en tête d’exploiter le temps qui nous est attribué pour développer le travail en dehors de l’université ; permettre que ses ressources, de les espaces photocopies au wifi, soient utilisées pour ceux qui en ont besoin ; et que celui qui a accès aux ressources financières les utilise pour aider aux besoins des militants. Plutôt que d’être de simples infractions, ces pratiques fonctionnent dans une zone contestable – celle du compromis des universités envers le service public, qui rarement est défini et peut très bien vouloir dire travail militant. L’administration de Trump a certainement contraint tous ceux qui sont au centre et à gauche à établir de nouvelles alliances, mêmes si elles ont leurs limites.
Ceci dit, mon programme en tant que militant visuel est, comme tu dis « vider le musée, décoloniser le programme et ouvrir la théorie ».
« Vider le musée » signifie que la propriété culturelle expropriée doit être rendue à ses propriétaires légitimes. Les Marbres d’Elgin doivent retourner à Athènes où un musée vide les attend. À Ramallah, le Musée de la Palestine est également vide de tout contenu. Quand le Musée Juif de Berlin, conçu par Daniel Libeskind, a ouvert ses portes, il était également vide et de nombreuses personnes pensaient qu’il était ainsi plus expressif. Une question cruciale est la restitution de la propriété culturelle indigène, particulièrement en ce qui concerne les objets sacrés et les restes humains des défunts. Au Musée du Couvent du Carme, ici à Lisbonne, les corps de deux Amérindiens sont exposés dans des vitrines à la bibliothèque : y aurait-il un meilleur exemple de la nécessité de décolonisation des musées ? Aux États-Unis, de nombreux objets indigènes ont été rendus dans le cadre d’un contexte juridique créé pour aider les revendications des peuples autochtones. Il y a pourtant toujours de nombreux objets à contempler. Mon objectif est d’imaginer comment serait un « musée » qui ne serait pas rempli de matériels expropriés et non spécifiques. Des lieux comme le Metropolitan Museum of Art, le Louvre ou le British Museum seraient très différents. Une collection comme celle du Tate Britain, axée sur les dons de Turner à la Nation, ne changerait pas tant que ça. Mais, l’objectif n’est pas de créer des programmes nationalistes. Le musée est déjà une industrie de services, par-dessus tout vouée à une circulation de capitaux (touristes). Et s’il y avait des espaces ouverts aux communautés locales et aux artistes de toutes sortes dans ces palaces de la culture ?
« Décoloniser le programme » est l’exigence spécifique du mouvement « fall » [tomber par terre] en Afrique du Sud, créé à la suite de #RhodesMustFall; #FeesMustFall; et du très controversé pour le moment #ZumaMustFall. Là, le retrait d’une pièce d’art colonial, la statue de Cecil Rhodes, a permis à l’époque aux étudiants de résister avec succès à l’augmentation des frais de scolarité et ensuite d’affronter le chef de l’état. Un autre aspect de l’activisme étudiant a été l’engagement dans le mouvement de la décolonisation. Son but n’est pas le retrait de la production académique « blanche » mais plutôt la réorganisation du programme à partir d’une perspective africaine. Ce mouvement comprend une reconsidération des façons d’orchestrer l’apprentissage, des structures formelles utilisées pour l’évaluation et de la façon dont la relation étudiant-professeur peut être imaginée différemment. Ces objectifs sont à relier à l’éducation décoloniale proposée par des figures comme Paulo Freire, Gloria Anzaldúa, Silvia Federici et Augusto Boal. Contrairement à de nombreuses « réformes » euro-américaines du système éducatif, qui se concentrent uniquement sur l’augmentation des performances des études de troisième cycle ou sur l’adaptation des cours aux supposés besoins de la technologie et de l’ingénierie, le mouvement pour décoloniser le programme se focalise sur les besoins humains et non-humains de la biosphère présente et future. Mon travail consiste à suivre ses efforts plutôt que de donner une direction. Ce qui fait une grande différence dans la façon dont j’organise les opportunités d’apprentissage. Je m’implique comme les autres et dans ce que je considère être mon rôle. Tout ceci est en cours et fait partie de mon travail quotidien.
Comme « ouvrir la théorie ». J’imagine « ouvrir » [open] ici plus comme un verbe que comme un adjectif : comment ouvrons-nous la théorie à ceux qui s’en considèrent exclus ? La low theory de McKenzie Wark est intimement liée à cette idée. Son projet traite d’idées utilisables et exploitables. Ouvrir la théorie est une injonction pour être autant inclusif que possible. Les nouvelles formes de langage ne s’y opposent pas. Les activistes trans ont modifié notre approche aux pronoms par exemple et les féministes nous poussent à penser « intersectionnellement ». Ces termes sont utilisés dans les débats militants et sociaux en cours. De cette façon, ouvrir la théorie n’est pas prendre une position anti-théorie mais c’est contre l’élitisme, comme une fin en soi. Nous développons les meilleures idées qu’il soit, absolument. Mais si seule une petite élite d’hommes blancs très instruits peut les entendre, seront-elles réellement les meilleures idées ? Selon notre approche, il existe une autre façon de considérer cette question. J’encourage les gens avec lesquels je travaille à lire un texte comme Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon comme s’ils lisaient la philosophie de l’élite : ligne après ligne, avec la présomption de nombreuses interprétations possibles dans chacune d’elles. Il semble « normal » de le faire comme Hegel, Platon ou même comme les penseurs plus récents tels que Derrida. Mais les « œuvres politiques » sont lues de façon trop rapide et superficielle. Quand elle est associée à la décolonisation du programme, la « théorie », ce n’est pas seulement des mots sur une page, mais c’est également des choses qui se font, comme la carte innovante de l’utilisation de segments transgéniques créée par Pedro Neves Marques dans son exposition actuelle. Ou bien ce pourrait être le travail réalisé par le collectif Vizualizing Palestine qui a pour objectif de rendre l’occupation compréhensible. Ou bien les atlas urbains créés par des équipes dirigées par Rebecca Solnit, qui montrent tant de discothèques gays comme les endroits où il y a des papillons Monarques. Dans mon activité, je fais ce que j’appelle les « dérives de l’esclavage » : je vais à une institution culturelle et je déambule au hasard, à la recherche d’indices d’êtres humains réduits à l’esclavage. Non seulement leur représentation formelle mais la présence de sucre, thé, café ou coton – il convient de noter que la peinture a partir du XVIIIe siècle a été faite sur des toiles de coton, se substituant au chanvre, donc la majeure partie du « canon » de la peinture moderne repose sur le produit du travail esclave.
Le but collectif de ces efforts serait la création d’institutions alternatives. Certaines existent déjà, comme l’Islington Mill à Salford, et l’Open East à Margate (toutes deux au Royaume-Uni). L’artiste Emily Jacir a terminé de collecter des fonds pour un projet similaire à Belém (Palestine). Certaines personnes argumentent que ce devrait être à l’État de le faire et sur le long terme, j’en suis d’accord. Ces alternatives sont un moyen de préfigurer de nouvelles approches dans l’apprentissage et de faire pression sur les institutions financées par l’État pour qu’elles répondent.
 Y aurait-il un meilleur exemple du besoin de décoloniser les musées ? (…) Dans ma pratique, je fais ce que j’appelle les 'dérives de l’esclavage': je vais à une institution culturelle et je déambule au hasard à la recherche d’indices d’êtres humains réduits à l’esclavage. Non seulement leur représentation formelle mais la présence de sucre, thé, café ou coton – il convient de noter que la peinture a partir du XVIIIe siècle a été faite sur des toiles de coton, se substituant au chanvre, donc la majeure partie du 'canon' de la peinture moderne repose sur le produit du travail esclave. Crédit Mariojr
Y aurait-il un meilleur exemple du besoin de décoloniser les musées ? (…) Dans ma pratique, je fais ce que j’appelle les 'dérives de l’esclavage': je vais à une institution culturelle et je déambule au hasard à la recherche d’indices d’êtres humains réduits à l’esclavage. Non seulement leur représentation formelle mais la présence de sucre, thé, café ou coton – il convient de noter que la peinture a partir du XVIIIe siècle a été faite sur des toiles de coton, se substituant au chanvre, donc la majeure partie du 'canon' de la peinture moderne repose sur le produit du travail esclave. Crédit Mariojr
Vous avez écrit un nombre considérable de livres mais il semble que le Right to Look est un virage dans votre production intellectuelle. Dans Right to Look, vous expliquez que « visualité » plutôt que d’être un mot-clé pour la culture visuelle n’est ni un terme récent ni un terme neutre, et il ne peut pas être utilisé avec légèreté pour désigner tout ce qui est visible (comme certains ont tendance à le faire). De facto, vous expliquez que Thomas Carlyle a inventé le mot en 1841 pour signifier précisément la « visualisation de l’histoire », une histoire liée à la guerre – spécifiquement le besoin des généraux de visualiser les champs de bataille. Vous définissez alors « visualité » comme une « pratique discursive moyenne pour laquelle la domination impose l’évidence sensible de sa légitimité », en distinguant trois complexes visuels différents au cours du temps : celui de la « plantation », l’ « impérial » et le « militaire-industriel ». Je sens que l’idée d’un « complexe » est du plus grand intérêt méthodologiquement parlant puisqu’il met en évidence la dimension épistémique et dialectique des objets, des sujets et des actions au cours de l’histoire.
Vous pouvez développer plus la notion de « complexe de visualité » et parler des manières comment le « droit de regarder » [the right to look] peut constituer une tactique de contrevisualité en contraste avec le « gaze » ?
La visualité est le moyen de visualiser un champ de bataille en utilisant des idées, l’information, des images et l’intuition. Ce champ de bataille n’est pas vu directement par ceux qui le visualisent parce qu’il est trop grand pour être vu et les dirigeants ne risquent pas leur vie de cette façon-là. La visualité est un complexe parce qu’elle cherche à organiser la vie humaine et non-humaine dans une variété de registres – travail, discipline, châtiment, soins personnels – dans un cadre créé par la pratique de la guerre. La guerre est menée en différents « théâtres », de façons formelles et informelles, quelquefois entre armées régulières et souvent de façon « asymétrique » entre une armée et des résistants, que ce soit des peuples colonisés, des êtres humains esclavagés ou révolutionnaires. La visualité produit également une simplification jusqu’à comprimer toute la guerre asymétrique en quelque chose qui s’appelle la « contre insurrection », dans un effort pour délégitimer le conflit et finir avec l’appui du peuple qui le reçoit. Ainsi, à discuter stratégie militaire, il devient rapidement nécessaire de penser à des formes mentales. Pour cela, le complexe est aussi un ensemble de façons de voir le monde avec l’intention de le comprendre.
Si ce moyen de faire la guerre tient son origine à l’ère napoléonienne comme annoncé dans les écrits stratégiques de Clausewitz et qui sont encore aujourd’hui enseignés aux soldats, il y en avait déjà beaucoup qui avaient été adoptés dans la plantation coloniale – ou comme on aurait dû le dire avant, sur le champ de bataille esclave. Là, le surveillant voulait donner l’impression qu’il pouvait de facto gérer toute l’activité des esclaves, qu’il puisse la voir ou non. L’époque formelle de la visualité en tant que technique militaire a été inaugurée par la transformation historique de la révolution bien suivie contre l’esclavage en Haïti. Cette révolution a été, et d’une certaine manière est encore, « inimaginable » selon les termes de Michel-Rolph Trouillot. La surveillance [oversight] devrait être freinée. Mais oversight en anglais peut également signifier « ne pas voir » ou être négligent. Ainsi, la visualité n’est pas simplement le pouvoir. Elle renforce le pouvoir avec autorité, une dimension-clé dans la manipulation de l’ordre du point de vue de l’esclavagiste, du colonisateur et de sa descendance - le capitalisme. Pour cela, il existe une contradiction au cœur de la visualité. C’est à ce moment précis que la « loi du gaze » se transforme subitement en « droit de regard ». On l’a vu à de nombreuses reprises dans la politique mondiale dès la publication du livre, de Tahrir à Black Lives Matter et Rhodes Must Fall. Cependant, la théorie du « gaze » appartient au dispositif spécifique du cinéma. Le drone, qui est épithète de la visualité aujourd’hui, n’est pas exactement le même dispositif. Le drone traduit le monde dans une abstraction bidimensionnelle. Être visible dans cette abstraction équivaut à être susceptible d’être mort. Mais le drone a si peu de capacité à distinguer les gens que ses opérateurs font des points sur les cartes SIM à leur place. Avec cela, je veux dire qu’ils identifient une carte SIM comme appartenant à une « cible » et quand ils la rencontrent, ils la détruisent. C’est le hasard qui indique si la cible possède cette carte à ce moment-là ou non, ce qui conduit à un nombre important de victimes civiles causées par les drones. Le drone est un téléphone à ailes, mais ces ailes sont bruyantes et mues par un moteur d’hélice bas de gamme, dont le bruit fait partie du régime de terreur produit par les drones.
Par opposition à la vue d’en haut, c’est, et cela a toujours été, une vue à partir du sol. Au sol, nous cherchons à être vus, à entendre et à voir les autres. Pour générer un « droit de regard », nous regardons d’abord les autres et attendons de voir ce qu’ils ont à dire, et seulement après, nous répondons, même s’ils ne parlent pas, et surtout dans ce cas. Parler en premier, c’est désigner et coloniser. Un selfie est, dans ce sens, une réponse symptomatique au système de surveillance anti-insurgés. En prenant des selfies, les gens essaient de s’enregistrer eux-mêmes comme s’ils tenaient des vies qui leur tiennent à cœur et qui peuvent être vécues. Ce ne sont pas des produits de narcissisme, comme tant de gens l’ont écrit, mais d’anxiété. Quand un espace d’apparition est formé, comme chez Tahrir ou dans une action de Black Lives Matter, les corps se positionnent à un endroit où ils ne devraient pas être. A ce moment-là, ils créent celui que Fanon appelait de « table rase » de la décolonisation. A partir de là, tout peut arriver. Ce qui est alors dit ou vu n’est pas simplement contre-visualité, une réponse à l’acte d’être visualisé, mais une alternative « inimaginable »: un espace d’apparition qui n’est pas formé par la guerre, par l’ordre et par l’autorité, mais par la possibilité de vivre ensemble. Nous n’apparaissons pas de la même façon dans cet espace parce que l’histoire ne disparaît pas. C’est dans cet espace que l’inégalité structurale peut être abordée.
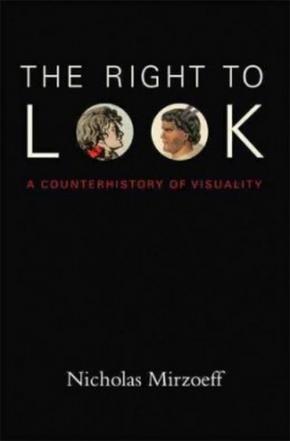 Au Portugal, j’ai été impressionné par la présence du visible, de ce qui est encore désigné comme 'explorateurs' ou les 'découvertes' au lieu de 'colonisateurs' et 'rencontre'. La représentation des corps africains dans l’art et sur les monuments officiels est souvent stéréotypée, voire dégradante'.Au Portugal, le souvenir de l’empire (1415-1974) perdure et comme n’importe quel autre souvenir, est partial et dissimulateur. Le souvenir officiel est toujours une description de l’héroïsme, comme les termes « découvertes » ou « expansion » à prévaloir sur « colonialisme ». Le rôle considérable que le Portugal a eu dans le trafic de esclaves - condamnant 5 848 266 personnes à l’esclavage (quasiment la moitié des 12 500 000 êtres humains asservis) - et la persistance du travail forcé après l’abolition de l’esclavage en 1869, jusqu’à plus récemment dans les années 60, sont largement ignorés. En plus de cela, il n’existe aucun monument rendant hommage aux victimes de l’esclavage qui pourrait servir de contre-exemple au discours impérial que Lisbonne profère en tant que ville, en particulier à Belém où la mémoire officielle est mise en scène. Ainsi, une « visualité » - qui à mon avis a été synthétisée avec soin, actualisée, (re)définie et intensifiée par la dictature fasciste (1926-1974) - a survécu à la Révolution des Œillets en 1974 et a des conséquences très concrètes dans la vie de beaucoup, en particulier des afro-descendants. De nos jours, cette « visualité » imprègne le sens commun, les discours politiques, les medias, les musées et même jusqu’à la littérature scientifique qui, proposant de faire sa critique, finit par exprimer le même usage colonial et colonisateur des images. De plus, l’analphabétisme visuel prévaut dans toutes les couches de la société (ce qui pourrait être lié au fait que la Culture Visuelle est à un stade initial ici). Je me demande jusqu’à quel point l’utilisation contemporaine des images et des discours du passé colonial ne ferait pas partie du même « complexe de visualité » qui a imprégné son moment de production, constituant une manière de perpétuer le besoin de ces images et de ces discours dans le présent.
Au Portugal, j’ai été impressionné par la présence du visible, de ce qui est encore désigné comme 'explorateurs' ou les 'découvertes' au lieu de 'colonisateurs' et 'rencontre'. La représentation des corps africains dans l’art et sur les monuments officiels est souvent stéréotypée, voire dégradante'.Au Portugal, le souvenir de l’empire (1415-1974) perdure et comme n’importe quel autre souvenir, est partial et dissimulateur. Le souvenir officiel est toujours une description de l’héroïsme, comme les termes « découvertes » ou « expansion » à prévaloir sur « colonialisme ». Le rôle considérable que le Portugal a eu dans le trafic de esclaves - condamnant 5 848 266 personnes à l’esclavage (quasiment la moitié des 12 500 000 êtres humains asservis) - et la persistance du travail forcé après l’abolition de l’esclavage en 1869, jusqu’à plus récemment dans les années 60, sont largement ignorés. En plus de cela, il n’existe aucun monument rendant hommage aux victimes de l’esclavage qui pourrait servir de contre-exemple au discours impérial que Lisbonne profère en tant que ville, en particulier à Belém où la mémoire officielle est mise en scène. Ainsi, une « visualité » - qui à mon avis a été synthétisée avec soin, actualisée, (re)définie et intensifiée par la dictature fasciste (1926-1974) - a survécu à la Révolution des Œillets en 1974 et a des conséquences très concrètes dans la vie de beaucoup, en particulier des afro-descendants. De nos jours, cette « visualité » imprègne le sens commun, les discours politiques, les medias, les musées et même jusqu’à la littérature scientifique qui, proposant de faire sa critique, finit par exprimer le même usage colonial et colonisateur des images. De plus, l’analphabétisme visuel prévaut dans toutes les couches de la société (ce qui pourrait être lié au fait que la Culture Visuelle est à un stade initial ici). Je me demande jusqu’à quel point l’utilisation contemporaine des images et des discours du passé colonial ne ferait pas partie du même « complexe de visualité » qui a imprégné son moment de production, constituant une manière de perpétuer le besoin de ces images et de ces discours dans le présent.
La question que je pose est celle-ci (cela n’est pas un problème exclusif au Portugal): comment combattre l’usage prédateur et le recyclage des matérialités et des images « coloniales », en particulier de la part des médias, des musées et plus particulièrement du milieu académique qui, de façon persistante, racialise les sujets et en revient à les inscrire dans une équation coloniale, d’où ils ne semblent jamais être sortis?
Le retour de l’empire et de la nostalgie coloniale et le (néo) colonialisme réellement présent sont des caractéristiques palpables du présent. Tout au long de The Right to Look, j’ai utilisé la terminologie de décolonialité et non celle de post-colonialisme. En résumé, la décolonialité est un projet au long cours, pour lequel l’expérience historique de l’après Seconde Guerre Mondiale n’a été qu’une partie importante. Le postcolonial est plus spécifique au sous-continent indien et n’est pas une condition générale ou mondiale. La théorisation de la colonialité et de la décolonialité tire ses origines du contexte latino-américain, où un demi-siècle d’exploration coloniale a créé des réserves quant à une déclaration de fin de cette ère.
En Europe et aux États-Unis, il y a aussi un retour spécifique de la forme et de la nostalgie coloniale. Au Portugal, j’ai été impressionné par la présence visible de ce qui est encore désigné comme « explorateurs » ou des « découvertes » au lieu de « colonisateurs » et « rencontre ». La représentation des corps africains dans l’art et sur les monuments officiels est souvent stéréotypée, voire dégradante ». Malheureusement, je n’ai pas vu ce cas comme une exception mais comme un exemple des nouvelles divisions. Les universités donnent un mauvais exemple dans ce domaine, les minorités et les gens de couleur étant systématiquement sous-représentés des deux côtés de l’Atlantique.
Je ne vois pas ça comme un signe de manque d’éducation visuelle, qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire - peut-être ce aurait été avant une question de connaissance des références visuelles? Je pense que cela a à voir avec la primauté de la « race »en tant que système visualisé de la hiérarchie humaine. Il est évident qu’il n’y a pas de base biologique ou génétique pour la « race », à moins qu’il ne soit évidemment possible de déceler des histoires différentes, avec des dénouements différents. Mais quand un policier regarde un suspect, s’il l’appelle d’un « hé, vous là-bas » comme ce fut parfois le cas pour Althusser, c’est parce qu’il reconnait ce suspect comme « blanc ». Pour un être humain racialisé, ce type d’interpellation n’existe pas et encore moins un « Passe ton chemin, il n’y a rien à voir ici », également adressé à une personne « blanche ». Quand la police « voit » une personne noire ou de quelque manière racialisée, la réponse sera violente. « Police » n’est pas seulement synonyme d’agents en uniforme mais représente tout un dispositif de la société de contrôle, comme l’a observé Deleuze. Mais Deleuze n’a pas souligné de quelle façon cette société est différenciée en interne en « zones » d’autocontrôle, proposées à ceux qui sont appelés « blancs » et en zones hautement contrôlées et autrement socialisées, où les gens peuvent être morts avec impunité, non pas comme homo sacer mais avec une marque de hiérarchie coloniale et racialisée.
Ainsi, le calendrier de la décolonisation est celui de la « démocratie d’abolition » - une démocratie où toutes les personnes sont finalement reconnues comme véritables et irrévocablement humaines et où il n’y a pas de police.
 Checkpoint à Qalqilya. Crédit NM. 'Il n’y a pas doute, le colonialité dans sa forme néolibérale est pernicieuse et appauvrit la vie (…). Décoloniser le media signifie en partie reconnaitre les formes par lesquelles les medias sont déjà toujours colonisés et en faire une utilisation décoloniale.'
Checkpoint à Qalqilya. Crédit NM. 'Il n’y a pas doute, le colonialité dans sa forme néolibérale est pernicieuse et appauvrit la vie (…). Décoloniser le media signifie en partie reconnaitre les formes par lesquelles les medias sont déjà toujours colonisés et en faire une utilisation décoloniale.'
Dans votre projet “How to See Palestine: an ABC of Occupation”, vous suggère que la Palestine est l’exemple contemporain le plus extrême du colonialisme : « Ma première impression la plus soutenue est sans équivoque: ceci, est ce que c’est le colonialisme ». Normalement, le passé nous aide à comprendre le présent. Mais dans ce projet, dans une tactique typique de la praxis de la culture visuelle, vous faite le contraire: pour comprendre le présent - le présent atroce de la Palestine - vous nous révèle le passé; un passé qui ne concerne pas seulement la Palestine.
Nick, vous pouvez en dire plus sur la méthode que vous avez utilisé ici et la nouvelle connaissance qu’il a produit sur la Palestine et l’expérience/les pratiques du colonialisme en général? Vous pensez que les possibilités ouvertes par les humanités numériques aideront à mieux visualiser la Palestine (et le colonialisme, passé et présent)? Ce sera le futur de la Culture Visuelle: visualiser notre présent - migration en masse, crise des réfugiés, guerre permanente, l’Antropocène, qui est directement lié au colonialisme - de façon à nous réconcilier avec le passé, et en le faisant, à sauvegarder nos futurs?
C’est un ensemble de questions très fascinant. En commençant par la Palestine, mon expérience a été que c’est là que j’ai vécu le colonialisme en tant que tel pour la première fois, ayant eu à écrire sur le sujet pendant longtemps. Il n’y a pas doute, la colonialité dans sa forme néo-libérale est pernicieuse et appauvrit la vie. C’est complètement différent de voir des gens sur lesquels sont couramment pointées des armes, de les voir conditionnés par les checkpoints tous les jours et être sujet à une domination permanente et humiliante. Parler avec des gens qui vivent à 40 miles (environ 65 kilomètres) de la Méditerranée et qui ne sont jamais allés à la mer - alors que de facto, c’est leur souhait. Entendre qu’un homme musulman ne peut pas aller à la mosquée de al-Aqsa à Jérusalem depuis 2001, à quelques kilomètres de chez lui, dans le camp de réfugiés de Aida à Belém. Savoir par les Bédouins que leurs chameaux sont prisonniers de la « Patrouille Verte » israélienne pour avoir envahi une zone écologique, comme si un animal de pâturage pouvait savoir cela. Et qu’après, ils doivent payer une amende de centaines de dollars pour récupérer l’animal. Avec toutes ces expériences et bien d’autres, il m’est évident que ceci est exemplaire, non exceptionnel. Ici, on a pu voir l’ordre colonial de nos jours comme il est réellement. Cependant, je ne suis pas spécialiste et je ne parle ni ne lis l’arabe, de sorte que je ne revendique pas une quelconque « compétence » académique. J’ai décidé de m’impliquer dans un projet de documentation performative comme je l’ai déjà fait auparavant. Le projet a ses règles: dans ce cas, j’ai écrit seulement sur des choses que j’ai vues et vécues, en utilisant des photographies que j’ai prises et de l’information que j’ai recueillie sur place, que ce soit au travers de gens avec lesquels j’ai parlé ou des médias locaux. Je me suis aperçue qu’il n’y avait pas une image mentale de la Palestine en dehors des images répétées de terreur, images pour lesquelles je me suis posée la question: « Comment puis-je voir la Palestine? » Comme débutante, j’ai utilisé le format ABC, avec vingt-six entrées rangées par ordre alphabétique.
Les médias numériques m’ont permis de créer et divulguer ce projet, ce qui n’aurait pas été possible sous format imprimé. Même si j’avais pu trouver une publication scientifique ou une revue intéressée par la publication de mes observations, qui aurait pris en compte le coût de l’impression des photographies en couleur, qui sont sûrement de qualité amateur mais qui montrent d’une façon naïve ce que j’ai vécu. Mais je ne suis pas certaine que cela compte comme humanités numériques. Les « HD » ainsi connues; elles semblent exiger la construction d’un nouvel outil pour analyser de données au lieu de les interpréter. En vérité, la désignation d’ « humanités interprétatives » est un appel à l’attention de personnes des « HD ». Un aspect politique n’est pas non plus perceptible dans la plupart des projets de « HD ». Le travail que j’ai fait ici pourra peut-être être vu comme une version amateur du projet Forensic Architecture dirigé par Eyal Weizman aux Goldsmiths, qui utilise les réseaux sociaux pour recréer et analyser les attaques israéliennes en Palestine. Mais son travail est très sophistiqué et novateur, alors que pour ma part, j’ai travaillé dans la tradition de l’enquête militante, ayant simplement mis mon corps où il n’aurait pas dû être et raconté ce que j’ai vécu.
Je suis d’accord avec l’évaluation plus exhaustive que tu as fait ici. Les présents à évolution rapide nécessitent des passés étudiés à nouveau pour les expliquer et les explorer. Mais tout d’abord, ils doivent être compris dans leurs propres termes. Cela requiert une certaine adaptabilité, mais il n’y a pas ici une infinie variété d’expérience. L’enquête en culture visuelle s’adapte bien aux moments d’anxiété massivement médiatisée, que ce soit dans sa forme aigüe comme lors du désastre de la Grenfell Tower ou les attaques terroristes; que ce soit l’expérience quotidienne de surveillance, du maintien de l’ordre et du contrôle négocié. Une image comme celle de Alan Kurdi, l’enfant de trois ans qui s’est noyé en tentant d’atteindre l’Europe, a franchi nos sensibilités endurcies non pas par pure pitié mais parce que la photographie a involontairement fait écho à l’archétype chrétien de la piéta. Soit les spectateurs ont fait ce lien consciemment ou non, elle leur permet de « voir » cette enfant morte sous un autre angle par rapport à des milliers d’autres qui n’ont pas été vues. Décoloniser les médias signifie en partie reconnaitre les formes par lesquelles ils sont déjà toujours colonisés et en faire une utilisation décoloniale.
![The Appearance of BLM (indice). 'Tandis que sous l’esclavage et à nouveau dans les prochains séparés alors à venir, la 'race' a été indexée sur les tons de peau les reliant à leur ascendance, [la Révolution Haïtienne de 1804] la dissociait du corps. Être Noir serait, dorénavant, la désignation de tous ceux qui resteraient à Haïti et iraient rejoindre sa révolution, indépendamment de son passé historique. Les personnes 'blanches' seraient celles qui auraient essayé d’être propriétaires de terres du pays, sans y vivre. La Négritude comme révolution. Le long spectre de la révolution haïtienne est certainement la preuve que cette reconfiguration a été amplement comprise'. The Appearance of BLM (indice). 'Tandis que sous l’esclavage et à nouveau dans les prochains séparés alors à venir, la 'race' a été indexée sur les tons de peau les reliant à leur ascendance, [la Révolution Haïtienne de 1804] la dissociait du corps. Être Noir serait, dorénavant, la désignation de tous ceux qui resteraient à Haïti et iraient rejoindre sa révolution, indépendamment de son passé historique. Les personnes 'blanches' seraient celles qui auraient essayé d’être propriétaires de terres du pays, sans y vivre. La Négritude comme révolution. Le long spectre de la révolution haïtienne est certainement la preuve que cette reconfiguration a été amplement comprise'.](https://www.buala.org/sites/default/files/imagecache/half/2017/06/6-the_space_of_appearence.jpg) The Appearance of BLM (indice). 'Tandis que sous l’esclavage et à nouveau dans les prochains séparés alors à venir, la 'race' a été indexée sur les tons de peau les reliant à leur ascendance, [la Révolution Haïtienne de 1804] la dissociait du corps. Être Noir serait, dorénavant, la désignation de tous ceux qui resteraient à Haïti et iraient rejoindre sa révolution, indépendamment de son passé historique. Les personnes 'blanches' seraient celles qui auraient essayé d’être propriétaires de terres du pays, sans y vivre. La Négritude comme révolution. Le long spectre de la révolution haïtienne est certainement la preuve que cette reconfiguration a été amplement comprise'.Une des choses que j’aime le plus dans votre travail est l’usage pratique que vous avez fait des concepts des autres auteurs, les amplifiant à un autre niveau, leur donnant une matérialité, une forme visuelle. Vous avez fait cela avec Jacques Rancière dans The Right to Look et récemment avec la lecture que Judith Butler a fait du concept d’« espace d’apparition » de Hannah Arendt dans son nouveau livre, The Appearance of Black Lives Matter (téléchargement gratuit ici). Qu’est-ce que cet « espace d’apparition »? Qu’ajoute-t-il au « droit de regard »; aux « tactiques de contrevisualité »? Et que dire de ce changement de « nommer » par « écouter »? Quelles promesses y-a-t-il en cela?
The Appearance of BLM (indice). 'Tandis que sous l’esclavage et à nouveau dans les prochains séparés alors à venir, la 'race' a été indexée sur les tons de peau les reliant à leur ascendance, [la Révolution Haïtienne de 1804] la dissociait du corps. Être Noir serait, dorénavant, la désignation de tous ceux qui resteraient à Haïti et iraient rejoindre sa révolution, indépendamment de son passé historique. Les personnes 'blanches' seraient celles qui auraient essayé d’être propriétaires de terres du pays, sans y vivre. La Négritude comme révolution. Le long spectre de la révolution haïtienne est certainement la preuve que cette reconfiguration a été amplement comprise'.Une des choses que j’aime le plus dans votre travail est l’usage pratique que vous avez fait des concepts des autres auteurs, les amplifiant à un autre niveau, leur donnant une matérialité, une forme visuelle. Vous avez fait cela avec Jacques Rancière dans The Right to Look et récemment avec la lecture que Judith Butler a fait du concept d’« espace d’apparition » de Hannah Arendt dans son nouveau livre, The Appearance of Black Lives Matter (téléchargement gratuit ici). Qu’est-ce que cet « espace d’apparition »? Qu’ajoute-t-il au « droit de regard »; aux « tactiques de contrevisualité »? Et que dire de ce changement de « nommer » par « écouter »? Quelles promesses y-a-t-il en cela?
C’est une observation pertinente, je pratique réellement ces actes d’appropriation! En partie, c’est ainsi que j’ai appris à faire le travail que je fais et senti que j’avais pour tâche de ne pas prétendre inventer de nouvelles idées. Mais avant de montrer comment simplement j’ai ajusté une chaîne de pensée qui peut avoir un parcours déjà long. L’« espace d’apparition » est comme tu le dis, une expression de Hannah Arendt pour désigner l’espace où se fait la politique. Judith Butler a fait un usage fascinant de ce concept dans son étude de la Place Tahrir et du Parc Gezi. Mais je voulais affiner les deux utilisations. Arendt reconnait que l’espace d’apparition qu’elle imagine est celui de la cité-état grecque, ce qui veut dire que par définition, elle exclut les femmes, les êtres humains esclaves, les mineurs, les non grecs et ainsi de suite. Pour cela, je voudrais tout d’abord imaginer un espace d’apparition comme un endroit où les gens peuvent exercer leur droit de regard, un échange de regards de l’un à l’autre et inversement - regarder dans les yeux les uns des autres - qui ne peut être possédé ou représenté. L’avantage de le considérer comme un espace et non pas comme une revendication est de pouvoir être étudié à des moments et selon des façons spécifiques. A apprendre avec le Black Lives Matter et autres mouvements liés, cela m’a amené à voir cet espace d’abord et avant tout comme un « écouter ». Ni cette écoute ni le regard du « droit de regard » sont fait uniquement avec un des sens corporels. Au contraire, ce sont des manières d’être présent. Écouter est espérer que l’autre fasse la première approximation, verbale ou non, de façon à ne pas réclamer le privilège colonial de la nommer. Dans cette écoute, les formes inégales selon lesquelles les gens entrent dans l’« espace d’apparition » peuvent être reconnues et négociées.
Pour Butler, cette intersection est fugace, celle-là qu’elle nomme de « passage anarchiste » [anarchist passage]. C’est avec un grand soulagement qu’elle revient sur le territoire familial des normes et règlements foucaldiens. J’ai vu dans Black Lives Matter la possibilité d’un mode différent d’être, qui a été appelé abolition et dans lequel les normes et les règlements seraient déplacés définitivement. Je pense ici à la manière selon laquelle la Révolution haïtienne a utilisé sa Constitution de 1804 pour définir la négritude. Tandis que sous l’esclavage et à nouveau dans les prochains séparés alors à venir, la « race » avait été indexée sur les tons de peau, les reliant à leur ascendance; les Haïtiens la dissociant du corps. Être Noir (noir) serait, dorénavant, la désignation de tous ceux qui resteraient à Haïti et iraient rejoindre sa révolution, indépendamment de leur passé historique. Les personnes « blanches » seraient celles qui auraient essayé d’être propriétaires de terres du pays, sans y vivre. La Négritude comme révolution. Certainement, le long spectre de la révolution haïtienne est la preuve que cette reconfiguration a été amplement comprise.
Pour moi, la différence entre le travail que j’essaie de faire aujourd’hui et celui que j’ai fait dans The Right to Look est que, après Tahrir, après The Occupy et dans l’effort continu d’affirmer que les vies noires importent, je n’ai pas imaginé l’expérience révolutionnaire d’accorder et de réclamer le droit de regarder dans un espace d’apparition. Je l’ai vu et je l’ai testé, tout comme de nombreux autres. Déjà, il n’y a pas besoin du langage de la philosophie spéculative pour que cela puisse être exprimé par mes soins.
 BLM Millions March (2014). Crédit Anon. 'Écouter c’est espérer que l’autre fasse la première approximation, verbale ou non, de façon à ne pas réclamer le privilège colonial de le nommer. Dans cette écoute, les formes inégales selon lesquelles les gens entrent dans l’espace d’apparition peuvent être reconnues et négociées'.
BLM Millions March (2014). Crédit Anon. 'Écouter c’est espérer que l’autre fasse la première approximation, verbale ou non, de façon à ne pas réclamer le privilège colonial de le nommer. Dans cette écoute, les formes inégales selon lesquelles les gens entrent dans l’espace d’apparition peuvent être reconnues et négociées'.
Walter Benjamin a exhorté l’intellectuel à choisir consciemment le côté des communs (le terme de Benjamin était « prolétaires »), les exhortant à construire leur propre « improved apparatus » [dispositif amélioré]: « Un auteur qui n’enseigne rien aux écrivains n’enseigne à personne. Ainsi, ce qui importe est le caractère exemplaire de la production, qui est capable premièrement d’induire d’autres producteurs à produire, et en second lieu, de mettre un dispositif amélioré à leur disposition. Et ce dispositif est d’autant meilleur que plus de consommateurs réussissent à se transformer en producteurs - c’est-à-dire les lecteurs ou les spectateurs en collaborateurs ». En considérant l’ensemble de son travail-militant, je sens que vous avez mis au point un « improved apparatus » à notre disposition. En plus, votre cours sont habituellement des espaces collaboratifs (dans la meilleure tradition de Paulo Freire), ce qui a été accentué par votre implication dans les mouvements sociaux, et je suis certaine que ce séminaire à la FCSH-UNL ne sera pas une exception, comme cela est implicite sur le blog du programme: « Son résultat dépend des participants. Nous pouvons décider de changer ce que nous voulons. »
Vous pensez que la culture visuelle, tout du moins celle que vous même pratique, pourrait être imaginée comme un « improved apparatus » au service des autres, et en particulier des étudiants, qu’il devrait les inciter à produire leur propre dispositif et, dans ce processus, les transformer de consommateurs en producteurs?
Oui, je le crois.
Merci beaucoup, Nick, pour le temps si généreusement accordé.
* Cet entretien est la partie 1 d’un diptyque. Dans la partie 2, nous allons interviewer Marita Sturken, dont le travail se focalise sur la relation entre la mémoire culturelle et l’identité nationale et la culture visuelle. Professeure à NYU, Sturken a également dispensé, ces trois dernières années, des séminaires pour le Doctorat en Études Artistiques à la FCSH-UNL.